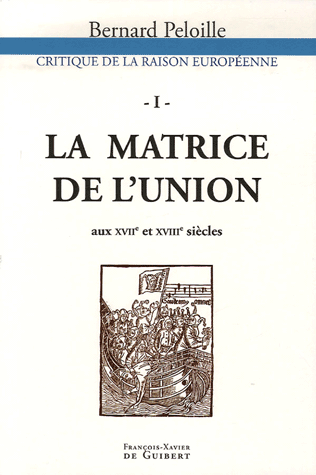Bernard Peloille : Critique de la raison européenne. I – La matrice de l’Union européenne, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, François-Xavier de Guibert, 2006.
La plupart des responsables politiques français acceptent “l’Union européenne” comme allant de soi, se bornant à en souhaiter une figure plutôt qu’une autre, sans jamais interroger cette prétendue « union » dans son principe même.
Dans La matrice de l’Union européenne au XVIIe et XVIIIe siècles, premier tome d’une Critique de la raison européenne, Bernard Peloille livre, en perspective historique, une analyse qui, à notre connaissance, n’avait jamais été engagée, celle de la formation de l’idée d’ “Union européenne” dans son principe même, et les enjeux sociaux et politiques qu’elle a pu recouvrir et recouvre. Remontant aux projets élaborés dès les XVIIe et XVIIIe siècles, il met au jour leur logique commune, dégageant la “matrice” de tous les projets d’union européenne élaborés depuis lors, éclairant par là les enjeux des discours européistes contemporains, mais aussi l’impossibilité historique de la réalisation d’une véritable « union ».
Dans tous les cas est à l’œuvre une même “matrice” qui porte à la déconstitution des formations historiques modernes, nation et État. Aujourd’hui comme hier, cette conjuration du progrès historique se présente aussi comme une figure de la régression historique de classes qui imaginent pouvoir contraindre la société moderne à réactualiser des formes propres aux relations féodales, que le développement social a dépassées.
Contexte historique d’émergence des premiers projets d’union européenne
L’idée d’union européenne se développe lors de la période de formation du capitalisme moderne, et des formes nation et État modernes.
Les premiers projets d’Union européenne, sont formalisés en France au XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier celui de l’Abbé de Saint-Pierre (ou Charles Irénée de Castel), le plus élaboré, paru en 1713. De profondes modifications s’opèrent alors dans le mode de production. En France, la formation du capitalisme, tout à la fois socialisant et anarchique, va de pair avec la formation des formes nation et État, dans leur réalisation moderne. Le capitalisme commence à prévaloir sur le régime marchand simple. Le rapport entre capital et travail tend à devenir prééminent, et à structurer, configurer la formation sociale, en tracer les bornes. Il permet la réalisation de ce que le régime marchand simple ne pouvait réaliser, le marché intérieur. La manufacture est alors la figure centrale pratique de ce processus qui demande que le capital puisse s’accumuler sur une grande échelle et enrôler sur une grande échelle la force de travail. L’argent, jusque-là concentré dans les mains des grands négociants, doit interrompre son cycle purement commercial pour pouvoir se convertir en facteurs de production dans les manufactures.
Le changement qui s’opère dans les rapports de production entraîne dans son mouvement toutes les classes de la société. Le capitalisme est un régime d’anarchie et de concurrence, mais il confère en même temps un caractère social à la production et aux forces de travail. Le développement des forces productives et du marché donne les conditions d’une lutte de classes globale au sein de la formation sociale, et entre en contradiction avec les pratiques improductives des rentiers, du clergé, des magistrats, de la grande noblesse, de la grande propriété foncière et des grands agrariens. Il se heurte aux intérêts particuliers en tout genre, notamment des grands négociants qui détournent l’argent de la production nationale. Il s’oppose aussi aux autonomies régionales, aux modes corporatistes, dont les droits contrecarrent le développement manufacturier et la formation du marché intérieur. En outre, ce développement capitaliste en France se heurte à celui d’autres puissances, l’Angleterre, la Hollande. C’est sur ce terreau que les projets d’union européenne germent et se développent.
Le pouvoir royal et son administration voient dans le régime de production de la bourgeoisie ascendante un moyen de développer la richesse du royaume et d’assurer sa stabilité intérieure et extérieure. Il cherche à le favoriser en œuvrant à ses conditions de réalisation.
« Il revient à l’État de régler les conditions du marché intérieur, c’est-à-dire assurer l’existence de tous les facteurs d’existence matérielle de l’ensemble de la formation sociale, nation, comme une totalité économique et spatiale cohérente. » (p. 36)
La politique d’État achève le processus de rupture avec les formes d’organisation du régime féodal. Le marché intérieur supposant le dépassement des particularismes et autonomies économiques, des métiers et corporations, l’État les subordonne au développement capitaliste ou les brise. Une telle politique revient à s’opposer aux groupes sociaux qui perdent, avec leur base matérielle, leur suprématie, et ne s’y résignent pas.
Le double caractère (social et anarchique) du régime capitaliste requiert de l’État un nouveau rôle. Dans la mesure où, en tant que régime économique, le capitalisme ne produit pas spontanément de formes politiques générales, c’est l’État seul qui peut imposer à l’échelle de la nation, la reconnaissance du caractère social de la production, dépassement nécessaire des rapports pré-capitalistes, en même temps qu’il doit pallier le mouvement anarchique du mode de production capitaliste.
« Ce seraient des raisons suffisantes pour justifier l’intervention de l’État, du moins d’un État soutenant le développement du capitalisme, non seulement contre l’ordre féodal mais contre lui-même, c’est-à-dire contre le libre jeu anarchique de ses propres lois. » (p. 31)
L’État concourt à ce développement en favorisant la concentration de l’argent dans les mains des entrepreneurs capitalistes, par la protection juridique des moyens de production manufacturiers, par le contrôle des importations (protection des productions nationales), en assurant l’approvisionnement en matières premières nationales ou extérieures, mais aussi par la mise à disposition d’une main d’œuvre concentrée. Bien que « le progrès historique [se fasse] alors dans une effroyable douleur du peuple », l’intervention de l’État contribue à faire reconnaître la production sociale et à poser le principe du soutien de cette production.
L’État tend à prendre un nouveau caractère, apparaissant comme
« le lieu superstructurel où devront se réfracter l’ensemble des conditions de la vie nationale, et qui doit en retour représenter à la formations sociale les conditions mêmes de ses conditions d’existence leurs cadres, leur projection, leur devenir ».
« Son rôle propre et spécial » est de représenter au capital
« ce qu’il ne peut se représenter à partir de ses conditions immédiates : ses intérêts unifiés d’ensemble dans la formation sociale et les conditions de sa réalisation historique ». (p. 38)
Le développement capitaliste entraîne dans son mouvement toutes les classes, ce qui porte à faire passer les affaires publiques du ressort exclusif du monarque à celui de toute la société. L’État peut se poser comme force concentrée et organisée des rapports sociaux, la figure d’une volonté générale exprimant le développement historiquement progressif du capitalisme. Il est la forme politique de cette société. Il se socialise. Il n’est plus l’État du prince, mais l’État que se donne la société, sous la figure de la monarchie absolue.
L’union européenne contre l’affermissement de la souveraineté de l’État et de la nation
Sous la figure de la monarchie absolue, la catégorie de souveraineté trouve les conditions pour se réaliser comme souveraineté de la formation nationale. Comme « qualité et pratique nationale », elle est « ce qui donne l’être et la forme à l’État », et par là « l’être et la forme du corps politique ». Le corps politique n’est pas en l’occurrence un pur être abstrait, une création ex-nihilo, et s’il peut se former, c’est sur l’être objectif qu’est le corps social constitué par les classes du peuple. Les formations nation et État, produits du développement historique et reconnaissance des conditions du développement social, sont aussi le cadre nécessaire à l’émancipation du peuple et à la possibilité de l’exercice de sa souveraineté. Leur négation contredit cette possibilité.
« Ainsi le peuple crée les conditions de la souveraineté, et la souveraineté doit lui donner une âme ». (p. 40)
Ces caractères de l’État moderne ne sont pas pour autant pleinement reconnus par un État concret « qui s’exonde du monde féodal ». La représentation du « nouveau » qu’il donne sous la forme de la monarchie absolue est encore marquée d’empreintes du monde féodal, dont il s’arrache. Cette représentation participe pourtant « du progrès historique d’institution du peuple en corps politique et par conséquent en souverain ». Les détracteurs du rôle nouveau que prend l’État, et du principe même de souveraineté, ne manquent pas pour autant de parer leur opposition foncière de vertus « démocratiques », afin de dissimuler leurs visées régressives à coups d’arguments contre la « tyrannie » absolutiste.
La formation des structures politiques qui accompagnent l’émergence du « nouveau » donnent lieu à des théorisations successives. Bernard Peloille met en relief le rôle de ces “trésors” de la pensée politique. La capacité à se projeter des conditions du monde présent vers celles de l’à venir, telle que la posent nombre d’auteurs, dont bien des noms étaient tombés aux oubliettes, donne à voir toute la richesse des concepts en formation. Pour nos contemporains submergés par un océan de thèses régressives, de stéréotypes, de manifestations d’une vie politique défaite, cette évocation ajoute à l’intérêt principal de cette partie de l’ouvrage.
Les projets d’union européenne en appui à la lutte des classes rétrogrades
On conçoit que les classes attachées ou bénéficiant de l’ordre féodal, évincées par l’émergence de nouvelles classes et rapports sociaux, hostiles aux idées nouvelles et menacées par ce nouveau rôle de l’État, ne se résignent pas à assister à la perte de leur suprématie, qui prélude à leur extinction historique. Dans le cadre de cette lutte de classes, elles produisent des thèses visant à légitimer leur pratique sociale régressive.
Si l’on pose la souveraineté comme clé de voûte de la formation du corps politique, qui en fait une forme aboutie, le postulat de base des projets d’union européenne, qui promeut la négation des formations politiques modernes, se présente comme un non-sens logique, non sens sur lequel sont bâtis, en construction inversée, ces divers projets, et plus particulièrement celui d’Irénée de Castel, abbé de Saint-Pierre, qui s’inscrit dans le cadre de ce combat. Celui-ci envisage en effet de priver de leur souveraineté les formations nationales et étatiques constituées, de les dissoudre dans une « union » qui prévaudrait sur elles. Pour ne pas effaroucher les candidats à une telle « union », il les répute cependant souverains.
Bernard Peloille fait état de l’argumentaire du projet qui réduit à néant cette pseudo reconnaissance des souverainetés. L’Union européenne projetée retire en effet aux formations constituées le pouvoir de dire et casser la loi, de décider de la guerre et de la paix, marques essentielles de la souveraineté. Les formations nationales sont placées sous la tutelle de « l’Union », sous son contrôle administratif et financier, elle peut s’ingérer sans réserve dans leur administration intérieure, les priver de leurs biens, et même de leurs sujets. L’enrôlement dans l’union est définitif, de sorte qu’aucune formation ne peut s’en retirer, sous peine de se voir contrainte par la force armée.
« L’union européenne » comme logique de régression vers des formes féodales et barbares
En privant les formations étatiques constituées de leur souveraineté, l’Union européenne prive le corps politique des nations de leur forme et de leur âme. Comme le met en évidence l’auteur, une « union » ne peut exister qu’entre des êtres singuliers, existant par eux-mêmes, formés, et ce principe est vrai pour les nations et les États autant que pour les personnes en tant qu’individus. En postulant la dissolution des nations et des États modernes historiquement formés, « l’union européenne » ne peut elle-même avoir de forme, de véritable constitution. Elle ne peut par conséquent être une « union », mais seulement un agrégat, informe. Informe, car n’étant pas la formation politique d’un corps social, ce qui ne se fait pas par décret, l’« union européenne » ne peut pas être à proprement parler « souveraine » (1).
La question est alors : à quoi peut ressembler l’État d’un tel groupement, si on l’examine au regard de l’État moderne, que le projet d’union européenne prétend dissoudre et remplacer. Dans un tel groupement fondé sur l’oppression de ses membres, oppression engendrant leur résistance, l’autorité publique est nécessairement conduite à se poser comme une bureaucratie. En outre, si la rébellion d’un État voulant quitter l’Union, doit être, selon le projet de l’Abbé, châtiée par elle, la rébellion peut au contraire être encouragée lorsqu’il s’agit de la sécession d’une partie de cet État, par exemple d’une « Province », par là même ressuscitée. Une formation politique qui reconnaît en même temps plusieurs règles, c’est la consécration de l’anarchie.
Cette conception s’oppose au principe de souveraineté, tel que le définissait déjà Bodin au XVIe siècle, principe qui récuse que la société soit soumise au principe des rapports de force spontanés s’imposant à la société, malgré elle. la conception qui dénie le principe de souveraineté des nations s’oppose aussi au principe de l’État politique moderne, qui, dans des conditions historiques données, permet une représentation des contradictions de la société, en vue de les surmonter ou les résoudre, de façon civilisée, afin de conserver cette société dans des formes stables et réglées.
Bâti sur le déni des formes politiques et du principe de souveraineté, le projet se révèle construction imaginaire et, mettant en évidence cet effondrement logique, Bernard Peloille, en dégage le principe régressif. Loin de régler les contradictions entre les protagonistes sociaux, « l’informité » de l’Union ne peut qu’en élargir l’échelle. N’ayant pas de forme propre, l’Union n’a pas de frontières rationnelles,
« elle est là où elle dit qu’elle veut et doit être, vouée à l’expansion permanente, elle est illimitée », « informe et illimitée par nature et par destination, elle est donc en état de guerre permanent par nature et par destination ».
Sa seule limite est la rencontre d’une puissance égale ou supérieure.
« Cet état de guerre permanent entre puissances est puissanciation de l’état de guerre entre les hommes singuliers au sein des formations sociales. »
L’Abbé de Saint-Pierre oppose aux formations nation et État une forme rétrogressive, fédérative impériale, fondée sur les formes ante-nationales et ante-étatiques, propres au monde féodal et semi-barbare. Il en cherche le modèle et le trouve logiquement dans l’Empire germanique. Son Projet s’inscrit dans un courant de pensée plus général d’opposition à ce que l’on peut considérer d’un point de vue historique comme progrès.
La négation de la souveraineté, de la nation et de l’État modernes, sont l’expression en idée d’une lutte de classe historique plus globale, celle de forces liées au monde féodal, en alliance parfois avec des fractions de la bourgeoisie qui sont en symbiose avec l’ancien ordre social des choses. Les idées des Saint Simon, Jurieu, Fénelon, Boulainvilliers, en sont des témoignages. Ces auteurs légitiment leurs projets de déconstitution des formations politiques modernes, en faisant état des défauts propres à la monarchie absolue, ce qui n’est pas sans rappeler des procédés contemporains. Ils peuvent aussi invoquer, tel Castel, un prétendu souci de « paix » européenne. A l’arrière plan des dénonciations de la “tyrannie” de la monarchie absolue, à travers la figure du monarque absolu est visé le principe même de la souveraineté, de la formation d’une unité nationale, et du nouveau rôle de l’État.
Toutefois, le véritable ressort du combat contre la “tyrannie” de la monarchie absolue, se fonde sur l’opposition de groupes sociaux qui, perdant la prééminence, ne peuvent espérer la sauvegarder ou la faire revivre dans les formes modernes, souveraineté, nation et État qui se constituent. Derrière l’éloge des « assemblées » contre l’arbitraire, derrière la peinture idéalisée de temps anciens contre la misère actuelle du royaume, derrière la critique des “parvenus”, c’est le déni du rôle des producteurs et du développement des forces productives qui s’exprime, le refus de la transformation des rapports sociaux, l’opposition aux formes politiques qui en sont la reconnaissance, et battent en brèche les formes féodales.
Dans la lutte de classes globale intense qui se déroule au cours de toute la période historique, la défense des privilèges de la noblesse et des groupes sociaux évincés suscite ainsi au sein du monde moderne, la floraison de courants d’idées visant à restaurer les rapports du monde féodal et barbare. Il s’agit de redonner vie à des groupements ante-sociaux, communautaires, de dépendance personnelle, sans médiation, sans objectivation, redonner vie à la suprématie aristocratique ou militaire « dans laquelle les hommes dépendent du maître, du chef, du seigneur, qui les possèdent comme leur chose ».
Une fois posé, le principe de régression est sans limites, il se prolonge jusqu’aux formes les plus primitives de tribus, de clans, d’ethnies. L’apologie des formes barbares n’est pas tirée par leurs auteurs des conditions du développement de la société réelle, d’une analyse du développement historique, mais élaborée comme inverse des formes sociales et politiques en formation. Ne pouvant se justifier ni par l’état réel de la société, ni par des processus historiques passés ou à venir, la régression doit trouver sa légitimation hors du monde de la société, dans le monde de la « nature naturelle ». C’est un renversement par lequel le développement moderne et les formations résultant de l’activité humaine, apparaissent comme une rupture et une régression par rapport à un état antérieur, à ce qui serait le cours naturel des choses. Cette forme « naturelle », se présente comme victime de la société « artificielle », et se projette dans un imaginaire qui se construit en une inversion de tout ce qui est reproché à la société. Ainsi Boulainvilliers loue les Francs sédentarisés, « égaux » et « propriétaires ».
Quel est le principe et la mesure de leur égalité et communauté de biens ? La force. Qu’est-ce qui règle le partage ? La volonté du chef, qui n’a rien à demander à sa multitude.
La communauté de biens ici évoquée repose en fait sur le pillage et la nécessité d’étendre sans cesse l’espace communautaire, une telle extension ne pouvant par conséquent avoir de bornes rationnelles. L’exaltation de la communauté (des biens pillés) n’est autre que l’apologie de la possession, d’un en deçà de la propriété, qui, là encore, s’oppose à la formation d’un corps social, et d’un corps politique.
Dans la promotion de la rétrogression, le germanique Herder est plus systématique.
« Des forces humaines vivantes sont le ressort de l’histoire humaine et comme l’homme tire son origine d’une lignée, sa complexion, son éducation et sa façon de penser sont par là même génétiques. »
« La santé et la durée d’un État ne repose pas sur l’apogée de sa civilisation, mais sur le sage et heureux équilibre de ses forces organiques agissantes. »
Chaque époque historique antérieure portant le péché d’avoir conduit à la suivante, jusqu’aux formes sociales et politiques modernes, Herder semble rechercher le « point de régression indépassable », « l’homme vrai » qu’il identifie expressément à la figure du barbare, spécialement du Germain, tribal et pratiquement sauvage, qu’il légitime comme figure inverse de l’institution de l’homme citoyen.
Et ce qui détermine l’homme citoyen, ce qui lui revient en propre, hors du mouvement involontaire de la « nature », indique l’auteur de la Matrice de l’Union, c’est précisément, « sa propre production et ses rapports sociaux ». « L’homme vrai » de Herder à l’inverse est « déterminé par ce qui n’est pas proprement humain, par son état naturel ». Autrement dit, il est indéterminé en tant qu’homme, opposé à « l’homme construit, c’est-à-dire à l’homme déterminé, instruit, institué ».
« La force qui pense et qui agit en moi est par nature aussi éternelle que celle qui maintient assemblés les soleils et les étoiles » écrit Herder.
« L’homme vrai » de Herder est mû par un destin, il est le jouet d’une force immanente, un « ça » qui « pense et agit » en lui. Il n’est donc pas responsable de ses actes. Il est « libre », comme le sanglier dans la forêt, déterminé par son biotope. Il ne transforme pas les conditions matérielles d’existence que lui donne le milieu naturel. Il ne développe pas les forces productives, il confisque celles des autres : cette « liberté » n’est que pillage et asservissement d’autrui. C’est le développement de la force, et non de la construction d’une société réglée, qui est l’objet du discours de Herder. Son « homme vrai » n’est pas libre, la liberté étant tout à la fois « l’acceptation volontaire de la nécessité de la détermination extérieure à soi-même », et sur cette base la possibilité pour les hommes d’agir sur ce qui dépend de l’homme, qui suppose intellection, conscience, pratique humaine se réalisant entre liberté et nécessité.
La conception de la déterminité « naturelle » des hommes et des groupements humains, telle que la pose Herder, transposée dans les conditions de l’époque moderne, conduit à figurer l’oxymoron d’un État non politique. Pour l’homme libre « naturel » et « vrai », la force vitale des rapports naturels, la force organique, prévaut sur la figure de l’État, produit de rapports humains construits, cette force vitale prévaut aussi sur toute forme humainement construite. En revanche, une telle conception ne s’oppose pas à « l’appareillage » des États, aux institutions bureaucratiques et de contrainte, de force armée.
Dans son introduction, qui présente l’ensemble des trois livres de sa Critique de la raison européenne, Bernard Peloille nous donne à voir l’enjeu des projets d’union européenne, comme expression de l’incapacité des régimes anciens à produire leur propre dépassement. Les groupes sociaux, ou les puissances, dont la suprématie ou l’existence n’ont pu s’émanciper de leur gangue féodale, se cabrent devant le progrès historique, n’espérant une issue qu’en coulant le monde moderne dans des formes historiquement archaïques. Une clé est ainsi donnée pour comprendre les enjeux contemporains de la “construction” d’une pseudo « union » européenne, en tant qu’elle ne peut être que la négation des formes politiques modernes : souveraineté, nation, État. Cette “construction” va de pair avec les tentatives de faire régresser les peuples vers des Empires pré-moyennâgeux, des formes communautaires, tribales.
Ce qui était à l’état de projets au XVIIe et XVIIIe siècles, se pose comme tentative de réalisation pratique deux siècles plus tard. Parce que la société bourgeoise, une fois épuisé son élan révolutionnaire, défaille à assurer l’intérêt général, et ne peut, lorsque ses antagonismes se manifestent, accomplir l’État moderne autrement que contre la société. Ce « défaut caché » de l’État bourgeois, pour reprendre la formulation de Marx, permet sans doute de rendre compte du fait que le projet d’Union européenne de Castel n’apparaît pas comme un corps d’idées propres à des siècles révolus, mais bien comme la « matrice » de projets et de pratiques singulièrement contemporains (2).
On attend avec impatience les deux Livres suivants de l’ouvrage.
NOTE
(1) On peut seulement envisager qu’en raison de l’inégalité de développement entre puissances agrégées, se dégage une puissance hégémoniste, captant à son profit la « souveraineté » des autres, ou plutôt leur défaut de souveraineté. Pour autant cette puissance ne saurait être vraiment souveraine, puisque lui fait défaut la formation historique d’un corps politique propre.
(2) A noter que pour les divers projets, comme les tentatives de réalisation, le caractère régressif se révèle proportionnel à l’immaturité, la faiblesse, la désinstitution des formes nation et État auxquelles ils s’opposent.